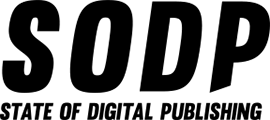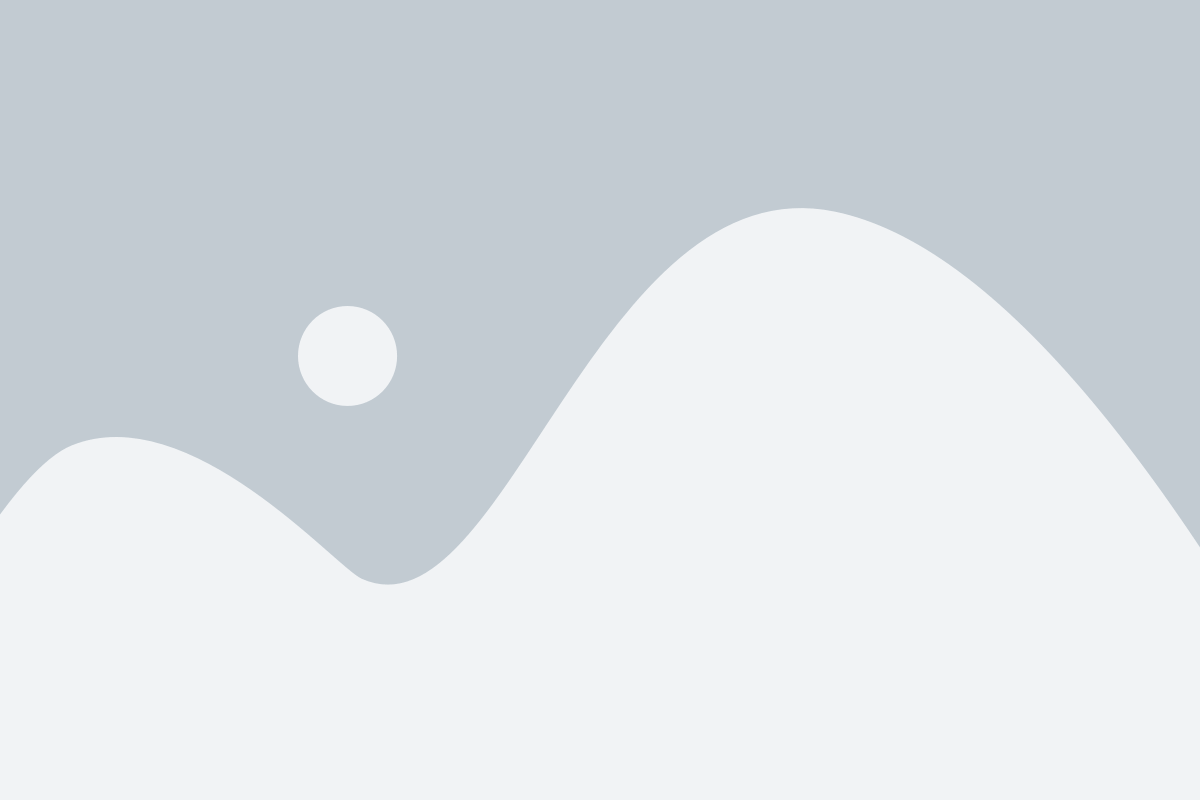Lorsque nous parlons de liberté des médias, nous l'entendons généralement en termes d'absence de restrictions légales inutiles, afin que les journalistes et leurs sources ne soient pas menacés de poursuites pour avoir dénoncé les méfaits des gouvernements.
Mais l'annonce faite hier par Meta (la société mère de Facebook) selon laquelle elle cessera de rémunérer les contenus d'actualité australiens constitue une menace d'un autre ordre pour la liberté des médias.
lois les plus progressistes au monde sur la liberté de la presse sont vaines si les entreprises de presse n'ont pas les moyens d'embaucher des journalistes expérimentés pour mener des enquêtes coûteuses. À quoi bon ces lois si aucun journaliste n'est là pour enquêter ?
Un élément essentiel de toute démocratie qui fonctionne est une presse libre, capable d'interroger les puissants et de demander des comptes aux gouvernements. Même dans un monde saturé de contenus numériques, nous reconnaissons la nécessité d'un journalisme de qualité, produit dans le respect des normes éthiques et professionnelles, afin d'éclairer le débat public et l'élaboration de politiques publiques pertinentes.
Ça allait forcément s'effondrer
Il y a trois ans, en 2021, en vertu du Code de négociation des médias d'information , le gouvernement a forcé Meta et Google à négocier avec les organisations de presse et à payer pour le droit d'accéder à leurs articles et de les publier.
Le gouvernement a introduit ce code après que Facebook et Google ont été accusés de diffuser du contenu d'actualité sur leurs plateformes , tout en privant les organes de presse des revenus publicitaires qui servaient auparavant à financer le journalisme.
Bien que nous ne sachions pas exactement qui est payé combien, on estime que les deux géants du numérique ont injecté environ 250 millions de dollars par an dans le journalisme australien.
Cela n'a pas suffi à mettre fin à la crise de l'information provoquée par l'effondrement des anciens modèles économiques, mais cela a permis de soutenir de nombreuses entreprises en difficulté. Dans certains cas, cela a même permis de financer des formes de journalisme qui, autrement, n'auraient pas été rentables.
L'un des principaux problèmes de ce système était qu'il poussait les entreprises de médias à conclure des accords intrinsèquement instables et imprévisibles avec des géants commerciaux, dont le seul intérêt pour l'information résidait dans sa capacité à générer des profits. Il était voué à l'échec dès que l'information deviendrait trop coûteuse et que les utilisateurs de Facebook s'en désintéresseraient.
Il est difficile de reprocher à Meta d'avoir jugé ces acquisitions non rentables. L'entreprise remplit son rôle, en prenant des décisions commerciales pragmatiques et en maximisant les rendements pour ses actionnaires. Cependant, les intérêts de Meta divergent de ceux du public australien.
Plus précisément, les intérêts de Meta divergent de ceux de notre démocratie. Meta n'a pas besoin d'informations de qualité, surtout si ses utilisateurs préfèrent partager des photos de famille plutôt que de suivre des analyses rigoureuses sur l'inflation. Mais, collectivement, notre société en a besoin.
L'information de qualité coûte cher. Envoyer un journaliste couvrir le de Taylor Swift à Melbourne ne coûte pas cher, mais couvrir la guerre à Gaza ou enquêter sur les allégations de corruption gouvernementale est extrêmement coûteux.

Je doute que beaucoup d'Australiens aient lu les enquêtes d'Adele Ferguson sur les pratiques de corruption de nos plus grandes banques . Ses investigations ont nécessité des années de travail et ont coûté bien plus cher que ce que le Sydney Morning Herald aurait pu récupérer en abonnements et en recettes publicitaires.
Mais son enquête a déclenché la Commission royale d'enquête sur le secteur bancaire et une série de réformes qui profitent à tous ceux qui possèdent un compte bancaire.
Une taxe sur l'information ?
Si l'on admet que l'information est un bien public, et non une marchandise comme le savon, il nous faut élaborer des modèles économiques qui permettent au public de la financer. On pourrait envisager une contribution, à l'instar de l'assurance maladie, qui reconnaît que, même si nous ne consommons pas tous l'information de la même manière, nous avons collectivement intérêt à bénéficier d'un journalisme de qualité, libre de toute pression commerciale ou politique.
C'est une conversation difficile à avoir, surtout quand la plupart des Australiens disent ne pas faire confiance aux médias , et que nous sommes de plus en plus nombreux à renoncer complètement à l'information .
Et cela nous amène à l'autre vérité que cette crise a mise en lumière : notre consommation médiatique a changé de façon irréversible . De moins en moins de gens lisent de longs articles ou suivent assidûment les bulletins d'information télévisés. Désormais, les vidéos courtes sur TikTok, YouTube et Facebook dominent. Le secteur de l'information doit s'adapter aux habitudes du public et accepter que les modes de présentation de l'information doivent eux aussi évoluer radicalement.
Nos façons de consommer l'information ont changé, les vidéos courtes étant désormais dominantes.
Il ne s'agit pas de suggérer que tout le journalisme doive désormais se présenter sous forme de vidéos TikTok. Mais contraindre les géants du numérique à soutenir financièrement des entreprises de presse datant de l'ère analogique ne fait que perpétuer un système devenu obsolète.
En tentant de faire payer les géants du numérique pour les contenus dont ils tirent profit, le Code de négociation des médias d'information partait d'une bonne intention. Mais maintenant que Meta a décidé que cela n'en valait plus la peine, nous avons l'opportunité de repenser et de refondre radicalement le financement et la diffusion de l'information, pour le bénéfice de tous.
Notre démocratie en dépend.
Peter Greste , professeur de journalisme et de communication à l'université Macquarie .
Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l' article d'origine .