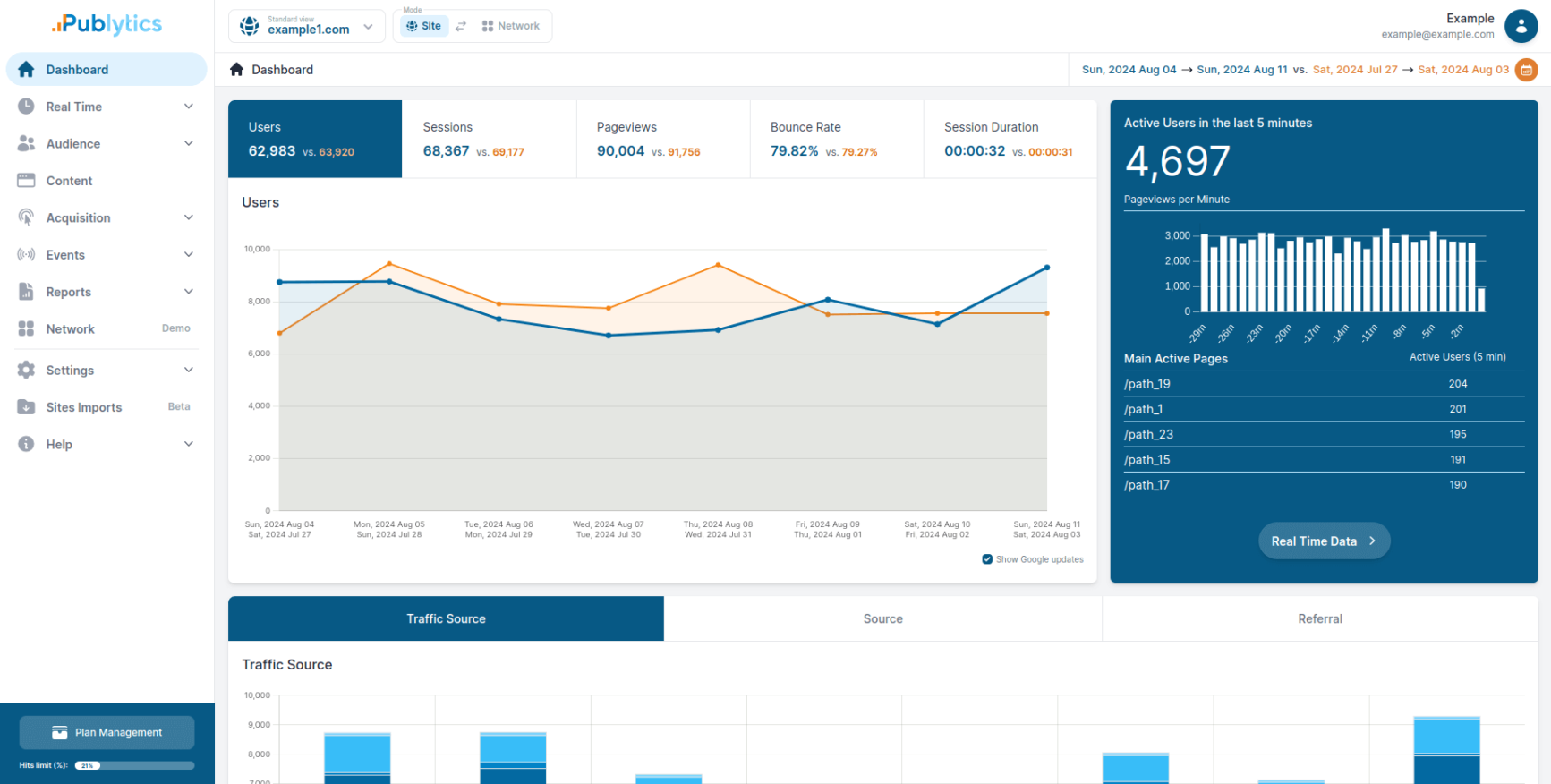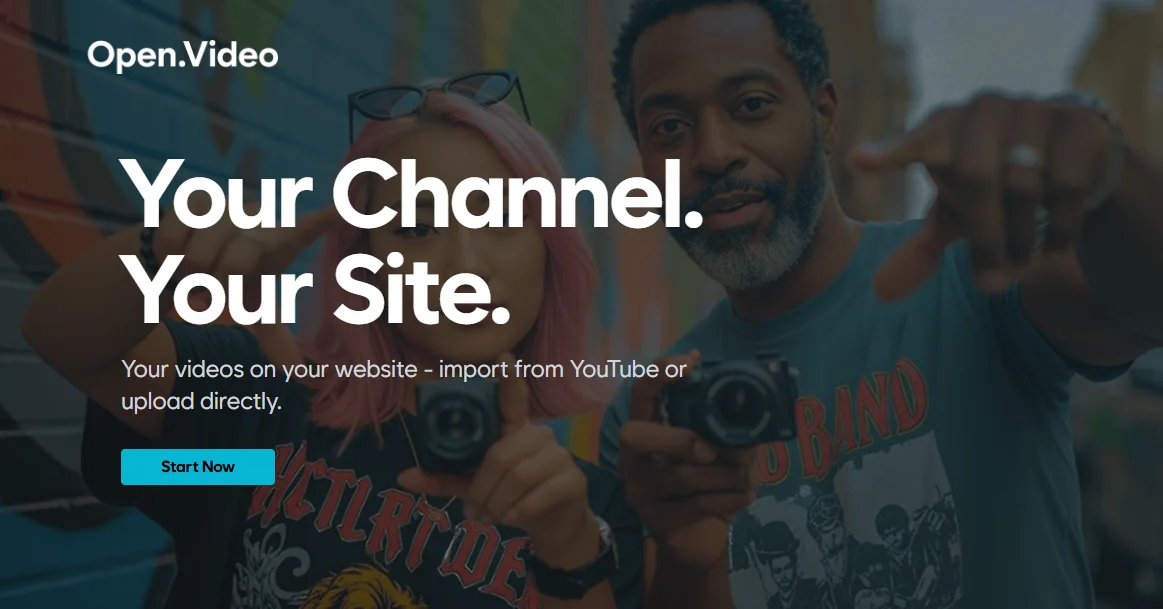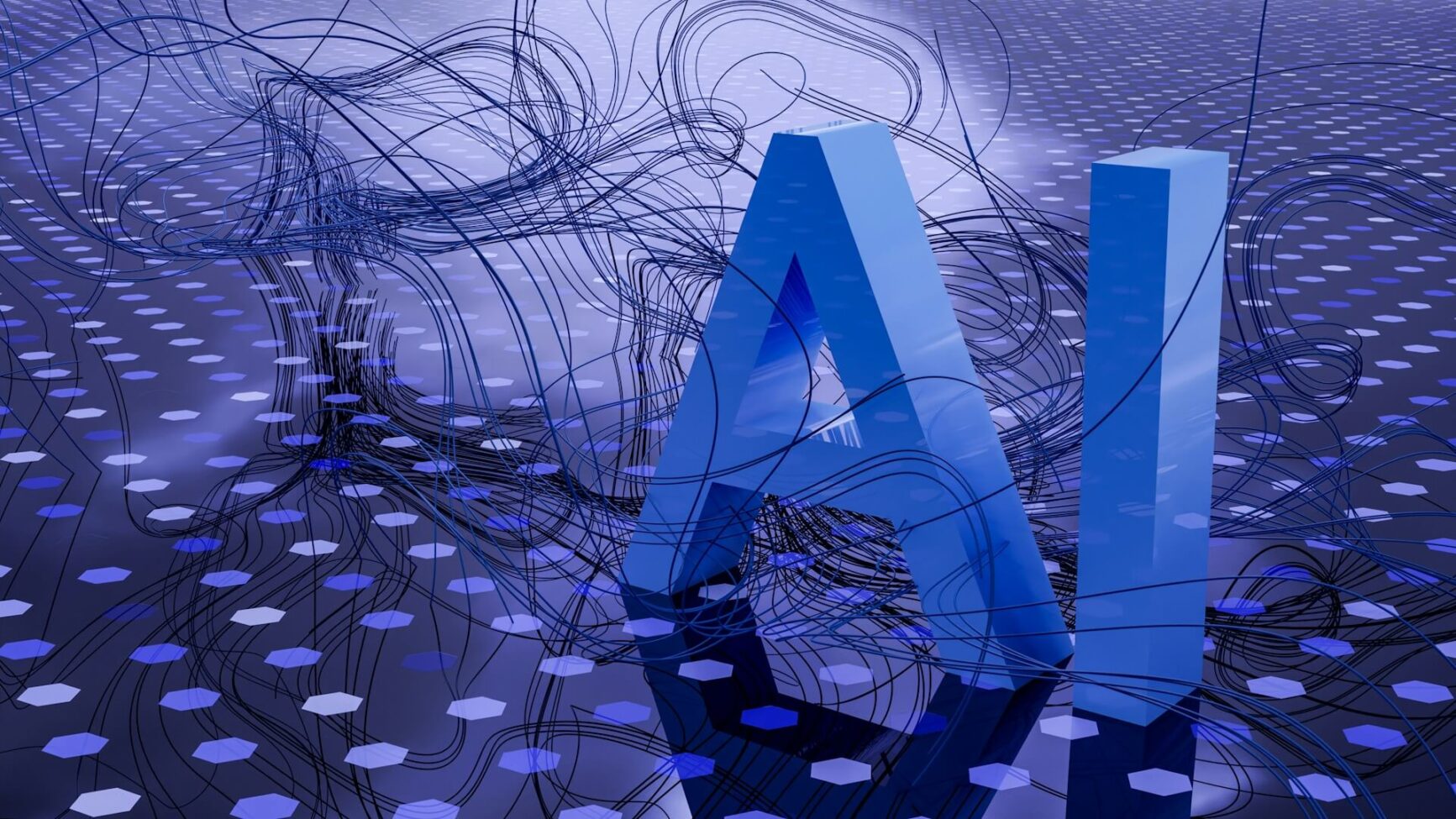D'un ton érudit, d'une portée considérable et d'un esprit mordant, le New Yorker a apporté une sophistication nouvelle – et indispensable – au journalisme américain lors de son lancement il y a 100 ans ce mois-ci .
En faisant des recherches sur l'histoire du journalisme américain pour mon livre « Covering America », j'ai été fasciné par l'histoire de la création du magazine et par celle de son fondateur, Harold Ross .
Dans un milieu professionnel haut en couleur, Ross était parfaitement à sa place. Il n'avait jamais terminé ses études secondaires. Avec son sourire édenté et ses cheveux en bataille, il divorçait fréquemment et souffrait d'ulcères.
Ross a consacré sa vie d'adulte à une seule cause : le magazine The New Yorker.
Pour les lettrés, par les lettrés
Né en 1892 à Aspen, dans le Colorado, Ross travailla comme reporter dans l'Ouest américain dès son adolescence. Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en 1917, il s'engagea. Envoyé dans le sud de la France, il déserta rapidement son régiment et gagna Paris, emportant avec lui sa machine à écrire Corona. Il rejoignit le tout nouveau journal destiné aux soldats, Stars and Stripes , qui recherchait désespérément des journalistes formés. Ross fut embauché sans la moindre question, bien que le journal fût une publication officielle de l'armée.

À Paris, Ross fit la connaissance de plusieurs écrivains, dont Jane Grant , qui avait été la première femme à travailler comme journaliste au New York Times. Elle devint par la suite la première des trois épouses de Ross.
Après l'armistice , Ross se rendit à New York et n'en repartit plus vraiment. Là, il commença à fréquenter d'autres écrivains et rejoignit bientôt un cercle de critiques, de dramaturges et d'esprits brillants qui se réunissaient à la Table Ronde de l'hôtel Algonquin, sur la 44e Rue Ouest à Manhattan.
Au cours de longs déjeuners arrosés, Ross côtoyait et échangeait des plaisanteries avec quelques-unes des figures les plus brillantes du milieu littéraire new-yorkais. La Table Ronde donna également naissance à une partie de poker informelle à laquelle participaient Ross et son futur bailleur de fonds, Raoul Fleischmann , issu de la célèbre famille de fabricants de levure.
Au milieu des années 1920, Ross décida de lancer un magazine hebdomadaire métropolitain. Il constatait l'essor du secteur de la presse magazine, mais n'avait aucune intention de copier ce qui existait déjà. Il souhaitait publier un magazine qui s'adresse directement à lui et à ses amis : de jeunes citadins ayant séjourné en Europe et lassés des platitudes et des rubriques prévisibles de la plupart des périodiques américains.
Mais avant tout, Ross devait élaborer un plan d'affaires.
Le type de lecteurs avertis que Ross recherchait était également prisé par les boutiques haut de gamme de Manhattan, qui ont donc adhéré au projet et manifesté leur intérêt pour l'achat d'espaces publicitaires. Sur cette base, Fleischmann, le partenaire de poker de Ross, était disposé à lui investir 25 000 $US pour démarrer , soit environ 450 000 $US actuels.
Ross se lance à fond
À l'automne 1924, utilisant un bureau appartenant à la famille Fleischmann au 25 West 45th St., Ross se mit à travailler sur le prospectus de son magazine :
« Le New Yorker sera le reflet, en mots et en images, de la vie métropolitaine. Il sera humain. Son ton général sera empreint de gaieté, d'esprit et de satire, mais il sera plus qu'une simple plaisanterie. Il ne sera pas ce que l'on appelle communément radical ou élitiste. Il sera ce que l'on appelle communément sophistiqué, en ce sens qu'il présupposera un certain niveau d'instruction chez ses lecteurs. Il abhorrera les inepties. »
« Ce magazine, a-t-il ajouté avec humour, n’est pas destiné à la vieille dame de Dubuque. »
Autrement dit, le New Yorker n'allait pas réagir à l'actualité et n'allait pas flatter l'Amérique moyenne.
Le seul critère de Ross était l'intérêt de l'article, et il était lui-même l'arbitre de ce qui était intéressant. Il misait tout sur l'idée, certes audacieuse, qu'il existait suffisamment de personnes partageant ses centres d'intérêt – ou susceptibles de les découvrir – pour soutenir un hebdomadaire soigné, impertinent et spirituel.
Ross a failli échouer. La couverture du premier numéro du New Yorker, daté du 21 février 1925, ne comportait aucun portrait de potentats ou de magnats, aucun titre à la une, aucune accroche.
Au lieu de cela, on y trouvait une aquarelle de Rea Irvin, ami artiste de Ross, représentant un dandy fixant intensément, à travers un monocle, – chose étonnante ! – un papillon. Cette image, surnommée Eustace Tilly , devint l'emblème officieux du magazine.
#CeJourLà en 1925
— Ron Lacy (@LRonLacy) 21 février 2024
: Eustace Tilley en
couverture du tout premier numéro du New Yorker, le 21 février 1925. Photo :
Rea Irvin. #TheNewYorkerCover #ReaIrvin #EustaceTilley pic.twitter.com/SaeEZvBILO
Un magazine trouve son équilibre
Dans ce premier numéro , le lecteur trouvait un véritable festin de blagues et de poèmes courts. On y trouvait également un portrait, des critiques de pièces de théâtre et de livres, de nombreux potins et quelques publicités.
Le résultat n'était pas très impressionnant, donnant une impression de bricolage, et le magazine a connu des débuts difficiles. Quelques mois seulement après la parution du New Yorker, Ross a failli tout perdre lors d'une soirée arrosée de poker chez Herbert Bayard Swope . Ross n'est rentré chez lui que le lendemain midi, et à son réveil, sa femme a trouvé dans ses poches des reconnaissances de dette d' un montant total de près de 30 000 dollars .
Fleischmann, qui avait assisté à la partie de cartes mais était parti à une heure raisonnable, était furieux. Ross parvint à le convaincre de rembourser une partie de sa dette et de le laisser travailler pour s'acquitter du reste. Juste à temps, le New Yorker commença à gagner des lecteurs, et de nombreux annonceurs suivirent rapidement. Ross finit par régler la dette de son mécène.
Une grande partie du succès du magazine reposait sur le génie de Ross pour repérer les talents et les encourager à développer leur propre style. Parmi les premières découvertes marquantes du rédacteur en chef fondateur figurait Katharine S. Angell , qui devint la première responsable de la fiction du magazine et une source inépuisable de bon sens. En 1926, Ross recruta James Thurber et E.B. White , qui se chargèrent de diverses tâches : rédaction de « casuals », de courts essais satiriques, dessin de presse, création de légendes pour les dessins d’autrui, rédaction de chroniques et commentaires.

À mesure que le New Yorker prenait son essor, les rédacteurs et les éditeurs commençaient à perfectionner certaines de ses caractéristiques emblématiques : le portrait approfondi, idéalement écrit sur une personne qui n’était pas strictement sous les feux des projecteurs mais qui méritait d’être mieux connue ; de longs récits non fictionnels, minutieusement documentés ; des nouvelles et de la poésie ; et, bien sûr, les dessins humoristiques en une seule case et les sketches humoristiques.
Contenu provenant de nos partenaires
D'une curiosité insatiable et d'une rigueur grammaticale obsessionnelle, Ross était prêt à tout pour garantir l'exactitude des propos. Les auteurs recevaient leurs brouillons couverts de questions griffonnées au crayon, exigeant dates, sources et vérifications factuelles à n'en plus finir. Une de ses questions fétiches était : « Qui est-ce ? »
Dans les années 1930, alors que le pays était plongé dans une crise économique sans précédent, le New Yorker fut parfois critiqué pour son insouciance face à la gravité des problèmes de la nation. Dans ses pages, la vie était presque toujours amusante, séduisante et divertissante.
Le New Yorker a véritablement pris son essor, tant sur le plan financier que sur le plan éditorial, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a enfin trouvé sa voix, une voix curieuse, internationale, introspective et, en fin de compte, tout à fait sérieuse.
Ross découvrit également d'autres auteurs, tels que A.J. Liebling , Mollie Panter-Downes et John Hersey , débauché du magazine Time d'Henry Luce. Ensemble, ils produisirent certains des meilleurs écrits de guerre, notamment le reportage historique de Hersey sur l'utilisation de la première bombe atomique en temps de guerre .
Un joyau de la couronne du journalisme
Au cours du siècle dernier, le New Yorker a exercé une profonde influence sur le journalisme américain.
D'une part, Ross a créé les conditions permettant à des voix singulières de se faire entendre. D'autre part, le New Yorker a encouragé et offert une tribune à une expertise non universitaire ; c'était un lieu où tous ces amateurs sérieux pouvaient écrire sur les manuscrits de la mer Morte, la géologie, la médecine ou la guerre nucléaire, sans autre qualification que leur capacité d'observation attentive, de réflexion claire et d'écriture efficace.
Enfin, il faut reconnaître à Ross le mérite d'avoir élargi considérablement le champ du journalisme, bien au-delà des catégories traditionnelles que sont le crime et les tribunaux, la politique et le sport. Dans les pages du New Yorker, les lecteurs ne retrouvaient presque jamais le même contenu que dans d'autres journaux et magazines.
En revanche, les lecteurs du New Yorker pourraient y trouver à peu près n'importe quoi d'autre.
Christopher B. Daly , professeur émérite de journalisme à l'université de Boston .
Cet article est republié de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l' article original .